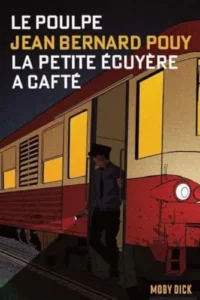C’est Gabriella Scheer qui m’a parlé de cette soirée qui porte bien ce nom intrigant : La Perdue. Animée par Lidia Martinez, la 6e édition a eu lieu ce vendredi 7 avril à Paris. Une invitation à explorer l’éternel retour au travers ses figures fondatrices, Ulysse, évidemment et Pénélope, sa fidèle épouse qui l’attend en détricotant durant la nuit les mailles du châle qu’elle tricotait le jour. Mais, me direz-vous, qu’est-ce qui fait retour et qui demeure, comme le suggère le titre de la soirée, irrémédiablement perdu ? J’ose une explication toute personnelle. La mère-patrie, pardi ! Mais, plus encore, ceux qui en sont les porteurs, au sens propre et figuré. Vous donnez votre langue au chat ? Pourtant la langue française, ici, est parfaitement transparente : la mère et le père réunis pour créer la chaleur du cocon familial. Que diable ! (On y reviendra.)
C’est Gabriella Scheer qui m’a parlé de cette soirée qui porte bien ce nom intrigant : La Perdue. Animée par Lidia Martinez, la 6e édition a eu lieu ce vendredi 7 avril à Paris. Une invitation à explorer l’éternel retour au travers ses figures fondatrices, Ulysse, évidemment et Pénélope, sa fidèle épouse qui l’attend en détricotant durant la nuit les mailles du châle qu’elle tricotait le jour. Mais, me direz-vous, qu’est-ce qui fait retour et qui demeure, comme le suggère le titre de la soirée, irrémédiablement perdu ? J’ose une explication toute personnelle. La mère-patrie, pardi ! Mais, plus encore, ceux qui en sont les porteurs, au sens propre et figuré. Vous donnez votre langue au chat ? Pourtant la langue française, ici, est parfaitement transparente : la mère et le père réunis pour créer la chaleur du cocon familial. Que diable ! (On y reviendra.)
A ce point, on pourrait tout aussi bien tirer d’autres fils sur le métier de Pénélope pour remonter vers cette entité controversée à laquelle nous sommes tenus de décliner notre identité : l’état-nation. Il nous tient dès notre naissance. Et plus encore. Cela explique que cette expression provoque des mouvements contrastés : la passion parfois poussé jusqu’au fanatisme ou l’aversion.
« Famille, je vous hais ! » La célèbre imprécation de Gide résonne encore à nos oreilles. Car ici tout est une question de forme. La petite comme la grande. Or, quand donc est-on chez soi ? Là est toute la question. Et c’est là où l’art joue sa partie et transforme la réponse en expérience transculturelle, c’est à dire en expérience artistique et donc éternelle.
D’emblée Jany Jérémie propose une interprétation graphique autour de la ruse d’Ulysse devenu Personne pour tromper le cyclope .Sous la direction et composition musicale de Pierre Sauvageot, Dominique Fonfrède et Kristof Hiriart ont lu un texte de Jean-François Goyet. Guy Segalen fera de même avec ses textes puis Évelyne Le Pollotec présenta « Une danse situationniste » avec une question clé : où habitons-nous ? Serait-ce notre corps, notre habitat primordial ? Éliane Béranger a lu des poèmes tirés de Le cri des femmes afghanes. C’est ensuite Gabriella Scheer qui brise de déchirer le voile du temps avec les paroles cristallines de Clarice Lispector tirées de son magnifique Nuit en montagne, écrit dans les alpes suisses. La diseuse nous donne à entendre toute sa profondeur avec ses plis, ses replis et ses silences avant que l’aube aux doigts de rose vienne la déplier lentement.
C’est grâce à cette immense écrivaine que nous nous sommes rencontrés elle et moi il y a quinze ans. Mais voilà que c’est au tour du Triton, mi dieu-mi poisson de prendre la mer ou plutôt la route avec sa canne au bout de laquelle un sac de toile rempli de pain sec est accroché. José Manuel Costa Esteves y donne une lecture bilingue du conte Homero, extrait de Contos Exemplares de Sophia de Mello Breyner Andresen. Mais ce triton là ressemble plutôt au Petit Poucet qui égrène son quignon de pain pour retrouver la maison. Mais que faire lorsqu’on la retrouve plus ? Même la musique interprétée par João Costa Lourenço; même la langue portugaise qui rappelle le ressac de la mer sur les galets n’y peuvent rien. Et qui plus est, dans l’obscurité du cosmos.
On est pris d’angoisse et du vertige pascalien par la dérive de l’astronaute du film Gravity narré par Daniel Berlioux « Je suis là ! » s’exclame t-elle à sa base de Cap Caraveral. Mais comment peut-on être là dans l’espace sidéral ? Cela ne veut plus rien dire affirme encore le metteur en scène qui nous rappelle que l’attention c’est de l’énergie encapsulée. Formidable équation qui ouvre le champs des possibles qu’il ne faut pas laisser dans les mains des publicitaires. Mais la voie du rapatriement car elle existe se fait aussi voix singulière qui monte dans cette petite salle surchauffée. C’est celle Mariana Fabião, soprano, qui chante Le Choix d’Hercule de Friedrich Haendel autant que Bernstein. Enfin retour aux sources c’est à dire à l’Odyssée où le poème chantée par Lydia Martinez devient tour à tour et tout à la fois faune et flore. João Costa Lourenço conclua par la Mélodie d’Orphée et Eurydice de Gluck et Sgambati. La boucle est ainsi bouclée. Celle qui avait commencée en début de soirée avec un extrait de La nostalgie, ce pénétrant essai de Barbara Cassin qui rappelle que ce substantif bien que d’origine grecque, est substantiellement suisse allemand. C’est « le mal du pays », le Heimweh.
J’avais découvert ce terme il y a près de quarante ans alors que je participais à la fondation de la revue trilingue ViceVersa à Montréal. Elle fédérait alors une bande d’immigrés et d’exilés, comme l’auditoire de cette salle en ce vendredi 2023. Beaucoup d’eau a coulé depuis sur le pont, comme on dit. La financiarisation de l’économie que nous redoutions alors s’est accomplie. Et nous nous retrouvons alors, collectivement gros jean comme devant, mais individuellement plus convaincus que jamais qu’il faut reprendre le chemin du retour, le chemin du pays. Mais dépouillé de sa douleur. Est-ce un hasard si la nostalgie revient en force sur la devant de la scène ? Je pense à Nostalgia, le beau et troublant film de Mario Martone. L’histoire est simple. Après 40 ans d’absence, Felice revient dans sa ville natale de Naples, dans le quartier Sanità, où vit encore sa mère. Et il décide envers et contre tous de s’y installer à nouveau.
Pourquoi revient-il ? Pour sa mère, bien sûr ! Toujours la mère. C’est elle qui nous rattache au pays par la langue (maternelle) d’abord et ensuite par la douleur du retour. La nostalgie est une drogue puissante surtout lorsqu’on veut en absoudre le passé. Or pour cela, il faut une fermeté de l’âme à toute épreuve. Et choisir son camp. Felice refuse. Il croit candidement qu’il peut encore pactiser avec son passé et pactiser avec le Mal. Double erreur qui le conduit à la mort. Celui qui porte le coup est son double, son meilleur ami, devenu un Caïn mafieux avec lequel il a dépassé les bornes. Et ceci à deux reprises. Une première fois lorsqu’il est complice du meurtre qu’il a commis et jamais dénoncé ; et la seconde fois, en pensant qu’il était encore l’adolescent qui est parti naguère.
Les bornes. Elles aussi font partie de l’équation. « Ne te retourne pas ! » aurais-je voulu lui crier. Felice n’est pas Ulysse mais Orphée voulant arracher Eurydice aux enfers. Le retour est impossible parce qu’il se fonde sur l’ignorance du temps qui transforme les personnes. Milan Kundera dont l’œuvre entière est scandé par l’éternel retour nous en fait la démonstration dans son roman l’Ignorance. Avoir de la nostalgie pour quelqu’un ou pour quelque chose, nous rappelle le romancier, « veut dire en espagnol anoranza qui vient du verbe anarar (avoir de la nostalgie) qui vient du catalan enyorar, dérivé, lui, du mot latin ignorare. Sous cet éclairage étymologique, la nostalgie devient la souffrance de l’ignorance ».
Cette perspective permet une nouvelle interprétation du « mal du pays » mais aussi des relations que nous entretenons avec ceux qui, proches ou éloignés, ont fait ou font partie de nos vies. C’est souvent le reproche que les femmes font à leurs conjoints. « Nous vivons ensemble depuis tant d’années et tu ignores encore ce que j’aime ! »
Air connu. L’ignorance de l’autre est la grande blessure, source de tant de malentendu et de conflits. Elle se manifeste à l’aube de la civilisation. Qu’Ulysse, « le plus grand aventurier de tous les temps soit aussi le plus nostalgique » (dixit Kundera), n’est pas anodin. Il nous dit quelque chose de notre humanité. Mais quoi ?
C’est ce que je cherche à savoir de ma propre condition. J’ai changé deux fois de pays faisant des allers retours de l’Ancien au nouveau Monde. J’écris ces mots dans une langue qui n’est pas la mienne. Alors vous pensez bien que le sentiment de ne pas être à ma place ne m’est pas étranger ! Ce sentiment d’illégitimité, d’être déplace a scandé ma vie durant. C’est pourquoi je n’ai pas combattu, laissant volontiers la place que je convoitais à d’autres.
La place que j’avais perdue se manifestait à foison dans mes rêves. Je revenais toujours à Montréal mais aussi dans ces curieux villages de vacances sans pour autant être sûr de repartir parce que souvent je ratais l’avion. C’est ainsi que, comme Ulysse, j’étais retenu prisonnier dans l’île de Calypso. Curieuse mais intéressante permutation où l’île de l’exil se transforme en paradis perdu. Terre perdue de l’enfance . Une autre boucle est bouclée comme dans la spirale qui monte vers le ciel ou descend vers l’abyme. La nostalgie, c’est ça, une une sorte d’énergie qui nous tient agrippé à l’espoir et qui exige notre attention pour pouvoir exister, être reconnu. Dilemme moderne par excellence.
Il y a longtemps que je voulais écrire sur ce thème. Peut-être l’ai-je toujours fait sans vraiment m’en rendre compte. Il était temps. Et c’est ça qui compte. Le temps réel d’une expérience singulière avec celle de l’autre. J’ai toujours cherché ce temps. Car j’avais l’impression d’y puiser ma force intime. Mais suis-je plus avancé.
Et si tout cela n’était qu’une stratégie de captation énergétique pour permettre de transformer l’énergie initiale en représentation en mesure de créer de la valeur. Car, à bien y penser une bonne partie de la littérature mondiale et qui plus est de la production moderne découle de ce sentiment pour y pallier en tout ou en partie. L’éternel retour est par l’attention nostalgique qu’elle produit le mécanisme même de la roue civilisationnelle : ce qui fait retour comme la révolution qu’elle soit politique ou industrielle. Car en terme cybernétiques il importe que le cycle cinétique s’accomplisse pour que l’énergie puisse être transformé en mouvement comme le piston d’un cylindre. Ou le châle de Pénélope qui la nuit se retrouve au point zéro. Vous me suivez ? Cela vous concerne aussi. Pour briser la chaîne de la répétition qui est aussi celle des contingences, il faut en connaître les mécanismes intimes . Comme dans « un jour sans fin » ! Cela implique aussi de déplacer l’objet de notre attention.
A bon entendeur, salut !