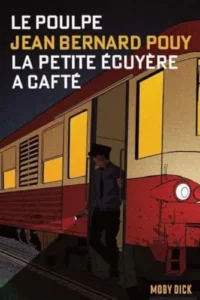Les tueries de Toulouse et de Montauban en France sont les dernières manifestations, s’il en est, de la crise que traverse l’espace public de nos démocraties libérales et de la diversité culturelle qui la sous-tend. Si naguère ces dernières sont parvenues à arracher l’espace public de l’emprise des fanatismes religieux et des plus forts (corporatismes, puissances de l’argent et mafias….), aujourd’hui par un paradoxal renversement de situation, les démocraties assistent, impuissantes, au retour des ces vieux fantômes au coeur même de l’agora.
Ces meurtres en série qui surviennent en pleine campagne présidentielle, l’illustrent tragiquement. Nombre des observateurs se focalisent désormais sur la persistance des dérives jhiadistes susceptibles de séduire encore les jeunes de banlieue. En fait ce genre d’analyse prend comme acquis que les influences travaillant l’espace public en France comme dans les sociétés dites avancées demeurent politiques et religieuses. D’où la surenchère d’explications à caractère éducatif et une réaffirmation en pagaille des « valeurs de la république ». En fait il y a belle lurette que ces valeurs sont dissoutes ou neutralisés par les forces du marché. Cette réduction ou plutôt cette inversion de l’espace public à sa seule valence économique-la seule croyance qui vaut est celle du marché- crée en contrepartie ce formidable appel d’air dans lequel s’engouffrent les extrémismes sectaires et leur cortège de violence.
Contrairement à ce qu’ils revendiquent , les adeptes de cette violence-là n’ont pas d’alibi. S’ils brandissent la cause religieuse, c’est comme artefact, comme une marque interchangeable. Cette violence est « transnationale », symptôme d’une société qui a retourné ses valeurs, qui est devenue amok pour reprendre le titre d’une des plus troublantes nouvelles de Stephen Zweig. Voilà pourquoi le débat sur la laïcité en France se trouve en porte à faux car il fait l’impasse sur ce qui reste largement occulté : les forces du marché qui orientent déjà cet espace pour le réduire en un simple réflexe de consommation pavlovienne , de stimili-réponse. La demande et l’offre se répondant, se comblant l’un l’autre en miroir en ne laissant aucun espace résiduel de liberté.
Comme le rappelle le philosophe italien Giorgio Agamben en citant Walter Benjamin, le capitalisme est la dernière des religions, « la plus féroce car elle ne connaît pas l’expiation ». Pourquoi ? Parce qu’il a capturé la totalité de la croyance humaine. Nous sommes plus que jamais gouvernés par des concepts théologiques sécularisés qui sont d’autant plus pervers qu’il sont inconscients.
Pareil au drame de Nanterre, il y a dix ans, cette tragédie se déroule au cours d’échéances électorales importantes. C’est un moment sensible où l’ensemble de la société renégocie les grandes orientations qu’elle souhaite donner à ses institutions à travers les femmes et les hommes qui vont les diriger. Or les institutions de la république comme de tout état, sont garantes du cadre dans lequel se déploient les activités humaines, assignent aux individus qui les constituent leur place et de ce fait assurent leur ancrage à l’intérieur de la société.
L’identité individuelle et collective se dégage de la relation qui s’opère entre l’individu et l’institution dépositaire de l’Histoire. C’est ainsi que chacun acquiert le statut de sujet et devient, de par ses critiques et ses oppositions à la tradition, partie prenante du processus de transformation politique de sa société tout en lui assurant du même élan sa continuité. La moindre attaque au fondement symbolique de ces institutions nous concerne tous car elle touche l’humanité même de tous par le geste d’un seul. Jadis la religion faisait des institutions politiques une émanation de la toute-puissance divine. Les démocraties ont su s’en émanciper par l’instauration de l’Etat de droit.
Aujourd’hui, soixante dix ans après la sanglante perversion de l’Etat par l’idéologie nazie, ces démocraties traversent une crise de légitimité. En France, comme ailleurs, cette crise a été perceptible de diverses manières et reflète la transformation de cet espace public. Pour en comprendre les tenants et aboutissants, il importe que nous saisissions la manière dont l’individu se relie avec ses semblables.
Le psychanalyste Jacques Lacan nous enseigne, après Freud, que c’est la loi du Père qui unit les deux registres du privé et du public. C’est le Nom du père comme métaphore qui arrache l’enfant des limbes de l’indifférenciation. Il suffit seulement que son nom circule selon certaines modalités pour séparer l’enfant du désir fusionnel de sa mère et l’instituer en tant qu’être singulier et manquant. C’est en cherchant à combler ce manque que l’enfant accède par la suite au symbolique et à la sphère de la parole et donc de la culture. L’une des conditions clés consiste à ce que le père soit lui-même séparé du désir de sa propre mère pour devenir à son tour un opérateur symbolique et installer la limite et par conséquent l’interdit.
Le forcené de Toulouse, comme d’autres tueurs de masse, ont souvent été élevés par des mères seules où la figure du père demeure absente. En passant à l’acte, Mohamed Merah dévoile ce manque qui fonde le lien social et pointe du coup l’absence tragique d’une véritable parole, d’une culture authentique permettant de l’exprimer. C’est en intégrant une culture authentique que chacun – et notamment ces jeunes hommes– peuvent devenir acteur de leur propre vie et manifester leur singularité dans l’espace public. Aujourd’hui au lieu d’assurer cette figure paternelle de la loi, l’Etat laisse le marché dicter les normes sociales. Plus que jamais il doit être le garant de cet espace public où doivent se manifester autant le pluralisme politique que culturel et les paroles pour les dire. La rupture totale avec l’autre si familier et pourtant si différent démontre l’échec du politique à pouvoir inverser la prévalence du privé sur le public et à refonder le lien social, c’est à dire un espace de parole.
Tout se passe comme si le désir d’égalité qui fut la grande cause politique du siècle dernier avait été pris au pied de la lettre et parodié jusque dans ses ultimes et effroyables conséquence par le marché.
Depuis plus de vingt ans soit depuis le début l’avènement de la financiarisation de l’économie, les sociétés avancées libèrent de la sorte la violence identitaire. Cela n’est pas propre à la France. La Norvège a vécu un drame similaire cet été. En Allemagne à Erfurt, il y a quelques années, un forcené abattait une dizaine de lycéens. Un peu plus tôt à Dunblane en Ecosse seize enfants d’une maternelle étaient assassinés dans des circonstance similaires. Et ne parlons pas de ces « faits divers » qui défraient régulièrement la chronique aux Etats-Unis, patrie de l’ultra-libéralisme, et dont le dernier avatar qui s’est déroulé en Afghanistan alors qu’un G-1 a tué des civils, n’y est pas étranger.
Que les instigateurs de ces événements fassent de la médiation audiovisuelle (caméra vidéo, cassette audio) l’instrument de leur tragédie, au même titre que les armes ou les explosifs, montre à l’évidence que tel est l’enjeu. Ainsi, ces derniers peuvent renouer d’égal à égal, l’espace d’un moment, avec la communauté des hommes par l’intermédiaire de l’espace public. Ce qui est en jeu c’est justement la reconnaissance de cette part d’humanité niée par un mode de vie anonyme par trop unidimensionnel que l’ultralibéralisme a exacerbé.
Ceux qui commettent ces actes ont souvent le même profil : même désir de servir sous l’armée, même fascination des armes, même désarroi et enfin même cri à l’égard du politique. C’est ainsi qu’il convient de l’entendre. En cette période électorale, il est important de réaffirmer l’irréductible souveraineté de la différentiation. Et la question qui la sous-tend : la place de l’autorité et de la loi.
Or l’autorité ne doit pas se manifester en bombant le torse comme il serait tentant de le faire, mais bien en assumant sa charge symbolique. C’est de la sorte que, se ressaisissant comme être manquant, chacun pourra renouer sa solidarité avec l’autre et avec sa propre société. Telle est l’alternative de notre temps où la révolte, faute de pouvoir se dire, se socialiser, se retourne contre l’homme. « Le jour, écrivait Albert Camus, où le crime se pare des dépouilles de l’innocence, par un curieux renversement qui est propre à notre temps, c’est l’innocence qui est sommé de fournir ses propres justifications ».