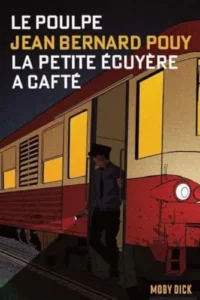On croirait entendre notre journal télévisé ! Le tour de force de l’auteur, expert des manuscrits anciens (ce qui n’est pas anodin) consiste à fracasser le plafond de verre qui maintient séparée notre propre actualité du flot des tragédies qui secouent le monde. C’est le fameux « effet d’apocalypse », marque de la fiction dystopique dont Evgueni Zamiatine en 1920 avait commencé à tracer les contours dans son roman, Nous autres, le bien nommé.
Depuis, le roman dystopique a connu de nombreux avatars ou permutations dont les plus connus sont Le meilleur des mondes d’Aldous Huxley, Fahrenheit 451 de Ray Bradbury, et bien sûr 1984 de George Orwell sans parler des déclinaisons les plus récentes comme les romans de Philip K. Dick , la Servante écarlate de Margaret Atwood (1985), Soumission de Michel Houellebecq ou 2084 de Boualem Sansal (tous deux parus en 2015).
Dix ans plus tard, Frédéric Castaing y ajoute la sienne en rendant la paroi entre le réel et l’imaginaire plus tenue encore. Car la réalité aujourd’hui dépasse la fiction. Aujourd’hui qu’on le veuille ou non, tous les romans sont dystopiques. Le philosophe Giorgio Agamben appelle « parodie froide » ou sérieuse, celle qui « ne remets pas en question, comme le fait la fiction, la réalité de son objet — au contraire, il est tellement insupportablement réel qu’il s’agit, bien plus plutôt, de le tenir à distance ».
La double distance
Ce réel insupportable, monstrueux, Castaing le tient à distance au double sens du terme puisqu’il en fait un journal volé dans la maison que l’auteur, un vieil homme, aurait abandonné lorsqu’il disparaît en nageant dans la mer. Incipit on ne peut plus littéraire dans le droit fil du roman picaresque. D’emblée l’auteur présumé et son époque sont donnés comme lointains et fabuleux. Or ce temps imaginaire n’est autre que le nôtre.
Le roman-journal commence à la veille de l’hiver, un 18 décembre, et se termine deux ans plus tard presque jour pour jour en comptant les heures. Dans l’intervalle se déploie la vie de son narrateur, le « professeur », qui vient tout juste de sortir de dix années d’emprisonnement soupçonné d’apologie du terrorisme. Il est libéré grâce à l’influence d’une personnalité haut placée et pas des moindres, c’est la ministre de la Guerre et des Départements d’outre-mer, « une belle femme, lunettes rouges, sneakers rouge sang » qui le fait décorer de la Légion d’honneur par le Président de la République, lui confie la direction de l’Institut de numérisation et dans la foulée en fait son amant. Le professeur consent sans mot dire. A-t-il des sentiments pour sa patronne ? Pas sûr. Les liens étroits qui les rattachent l’un à l’autre sont d’un autre nature : un passé commun. Celui-ci surgit toujours inopinément comme chez Winston Smith dans 1984, tel un paradis perdu. Une phrase l’annonce, énigmatique, comme un mantra. « Zzac : les doigts dans la prise ». L’électrocution ici est une anamnèse, une manière de s’absenter du présent et d’entrer violemment dans le souvenir. « Qu’est-ce qui ne va pas ? … J’ai mal au ventre, madame… c’est la troisième fois en deux mois, vous exagérerez. Vos parents sont à Champhol ?… Elle me laisse avec un thermomètre que je pose sur le radiateur… 39,8, comme la semaine dernière… Mes respects monsieur le maire… Et je m’allonge dans ce lit refuge… »
Le passé, seul repère
Car la mémoire de l’enfance demeure le seul repère dans l’actualité d’un monde sans dessous dessus. Les sentiments sont incongrus et les personnages, réduits à leurs allures ou leur fonction — le grand-dadais, l’évanescente, le linguiste, la ministre, la gamine.: ils n’ont pas de noms. À quoi cela leur servirait-il d’ailleurs ? Là n’est pas le sujet. D’ailleurs ils il n’y a pas de sujets. Il n’ ya que des objets qui vont et viennent come des pantins Car c’est l’actualité grande ou petite qui mène la danse . Et les événements changent si vite, comme la mode : « Sur le Pont-Neuf, ils ont remplacé la statue d’Henri IV par une montagne de smartphones compressés ; devant la Samaritaine, un gigantesque sac de luxe en dur flirte avec le dernier étage du magasin, et un gorille, facette bleue, est accroché à la tour Eiffel… Une tulipe géante qui clignote surplombe un petit square ». C’est notre réalité qui est décrite comme un film d’épouvante dont nous serions les spectateurs sidérés par les scènes banales et grotesques que l’actualité (pénuries, guerres, manipulations, hold-up, escroqueries, révoltes, répressions…) nous injecte. De quoi vomir. Et le héros narrateur vomit plus souvent qu’à son tour. Shooté aux neuroleptiques, sa nausée qui en rappelle une autre , plus sartrienne, n’est pas sans faire écho à une autre plus ancienne encore : « je vomirai les tièdes de biblique mémoire.
A la différence des discours dystopiques précédents mettant en cause le totalitarisme induit par une des formes contemporaines de l’idéologie — soit le capitalisme, le communisme, le masculinisme où l’islamisme — ici nulle idéologie apparente. Celle-ci s’est fondue dans la masse comme fond la banquise…, nul horizon d’attente n’est proposé. L’idéologie fonctionne à vide dans sa forme chimiquement pure. Idéologie désidéologisée, sidération désidérante, elle nous révèle notre propre vacuité qui n’est plus un horizon lointain mais un éternel présent avec ses guerres plus nombreuses et sanguinaires, ses jacqueries, ses IA, ses chômages, ses répressions, ses pénuries, ses injonctions…
La vie est belle , le film de Frank Capra sorti en 1946, a aussi sa variante dystopique réalisée un demi-siècle plus tard par Roberto Begnigni. Ce dernier y joue le rôle d’un père juif italien. Emprisonné avec son jeune fils dans un camp de la mort, il entend le distraire et ainsi le sauver en lui faisant croire qu’ils se trouvent tous deux enfermés dans une vaste comédie loufoque. Dans le film original, il y a également une scène dystopique où George, le personnage principal, endetté et déprimé, décide de mettre fin à ses jours ; il voit par l’intercession de son ange gardien ; ce que serait devenue sa ville si lui-même n’avait pas existé. Cette révélation lui dessille les yeux et il peut donc affronter sereinement la réalité.
Dans Zzzac Il ne reste que le passé : « Le dimanche à Champhol, j’ai mon arbre. Un sapin majestueux ajusté aux branches comme une échelle, qui jouxte la maison. Je grimpe jusqu’au dernier barreau et je reste des heures à l’abri. »