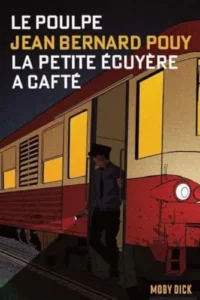La diversité culturelle est-elle l’idiot utile des populismes identitaires et, plus encore, des fondamentalismes religieux ? C’est une question qui revient en boucle dès lors qu’on aborde le thème de la différence. Elle s’est posée à moi de diverses manières tout au long de ces vingt années qui a conduit à la fondation et au développement de l’Observatoire de la diversité culturelle. Mais Le meurtre de Samuel Paty et le procès de l’attentat de Charlie-Hebdo nous invites à nous reposer la question plus que jamais en ce 9 décembre 2020, où l’on commémore la loi sur la laïcité. Et le cinéma demeure un excellent indications de ce débat qui reste encore peu discuté.
J’ai tenté d’y répondre dans un essai récent où j’ai expliqué le cadre diplomatique et international de la genèse de cette notion. C’est la mondialisation de l’économie amplifiée par internet qui a conduit en 2005 la très grande majorité des États membres de l’UNESCO à vouloir s’en prémunir à travers une Convention internationale qui pose le cadre juridique de la protection de le urs cultures nationales.
urs cultures nationales.
Mais cette notion, d’ailleurs promue par la diplomatie française, se complique encore davantage lorsqu’elle entre dans l’atmosphère nationale. Elle se confronte alors à la délicate question de l’identité collective et devient l’objet de toutes les manipulations. L’extrême gauche et l’islam radical ne se gênent pas pour l’instrumentaliser et se donner ainsi un vernis de légitimité à peu de frais.
Désormais plusieurs voix s’élèvent pour dénoncer cette complicité des contraires, ces « alliés objectifs » comme l’aurait dit Marx, et ceci tant dans l’espace politique, qu’associatif et philosophique. Parmi eux le philosophe Pascal Bruckner : « ils ont le même objectif : la volonté de détruire cette société, la recherche d’une rédemption par l’immigrant, l’étranger qui viendra régénérer nos vielles nations épuisés », analyse-t-il dans un racisme imaginaire, son récent essai décapant et bienvenu.
Et pour cause. Il s’agit d’associer la lutte contre l’islamophobie à la défense de cette diversité culturelle que toute nation démocratique se doit de préserver. L’immigrant, désormais « migrant » c’est-à-dire condamnée au mouvement perpétuel, devient ainsi la figure ambiguë de nos sociétés tétanisées par la peur de la violence qu’elles pensaient avoir jugulées. A la fois diable et démon, saint et paria, le migrant et notamment ses enfants « issus de la diversité » deviennent le miroir où se rejoue la loi du Talion.
Un exemple récent en est donné par « les Misérables » le premier film de Ladj Ly. Le titre renvoie au chef d’œuvre de Victor Hugo car c’est à Montfermeil où se déroule le film que Jean Valjean, le forçat repenti, y rencontre Cosette. Le véritable intérêt de ce nième film sur la banlieue un quart de siècle après La Haine de Mathieu Kassovitz, réside dans la manière dont il fait voir la genèse et la gestion de la violence dans les banlieues.
L’histoire nous est raconté du point de vue de la brigade anti-criminalité de Clichy-Montfermeil formée de trois flics, dont l’un, Stéphane (Damien Bonnard), débarque de Cherbourg, les deux autres étant Chris, (Alexis Manenti, qui cosigne le scénario) et Gwada (Djebril Zonga). C’est leur ronde dans la cite des Bosquets qui nous permet de comprendre les pouvoirs qui se partagent son territoire. D’abord il y a la bande des Africains, devenus «médiateurs » et chargés par la mairie de créer du lien social. Voilà pour les apparences mais en coulisse, ils continuent leurs petites combines et trafics. C’est la fameuse « paix sociale » achetée à coup de compromissions et de connivences par les politiciens locaux afin de garantir leur réélection. Ensuite il y a les gitans et leur cirque au sens propre et figuré prêts à tout casser si on ne leur ramène pas le lionceau qu’on leur a volé. Entre les deux il y a l’État représenté par les trois flics qui traquent un gamin ayant volé le petit félin. Il suffira d’une bavure, un tir au LBD qu’un drone a filmé, pour que la cité inflammable s’embrase.
Ceux qui tirent leur épingle du jeu dans cette démonstration de force où tout le monde a un fil à la patte (y compris la brigade où Chris est dépeint comme un raciste) , ce sont les frères musulmans qui par leur exemplarité, imposent une paix relative aux protagonistes prêts en découdre. Mais la violence resurgira, comme un retour de flamme et de manière inattendue au travers des plus jeunes lesquels échappent au contrôle de leurs aînés.
L’intérêt de ce film réside dans cette bascule de la violence qui n’est plus l’apanage des pouvoirs organisés et qui de ce fait dévoile ses ressorts élémentaires : l’humiliation puis la vengeance aveugle. Ce mimétisme binaire est connu depuis toujours. Et le réalisateur le saisit lors de cette ultime confrontation où Pento, le bon flic, est piégé dans une cage d’escalier face au jeune Issa qui, cocktail Molotov à la main, hésite à l’incendier. Moment dramatique où les rôles permutent, la victime devient le bourreau. Le film d’ailleurs se terminera sur ce face-à-face laissant le spectateur le soin d’apporter sa propre conclusion. La vengeance sera ou ne sera pas.
Cette fin pourtant spectaculaire comme l’est d’ailleurs le reste de ce long métrage, nous laisse toutefois sur notre faim (!) et signe du coup sa propre limite. A quoi sert l’art en général et le cinéma à fortiori sinon à sublimer, c’est à dire à pouvoir sortir de l’impasse du réel par le symbolique, inventer des possibles ? Ici au contraire les personnages en demeurent prisonniers comme si la violence était une fatalité dont la seule façon de s’en sortir consistait à imiter l’exemple des Grands Frères : c’est-à-dire les Frères musulmans.
Le réalisateur passe sous silence le prosélytisme de ce groupement religieux qui tisse sa toile dans les Cités de même que son idéologie misogyne et antisémite. Et gare à celles et ceux qui auront eu l’outrecuidance de la faire remarquer comme la journaliste Zineb El Rhazoui, ancienne de Charlie-Hebdo, ils auront droit de la part du jeune réalisateur à une réponse qui laisse pantois par sa violence et sa vulgarité. A telle enseigne que le site spécialisé « le blogue du cinéma », a décidé de retirer l’entretien compromettant qu’il leur avait accordé. D’autres, plus conciliants, argueront que tel n’était pas le sujet et que, somme toute, l’ancien militant s’est emporté parce que l’ activiste féministe n’y est pas non plus allée de main morte en appelant même les policiers à tirer à balles réelles lors des émeutes de banlieue) mais surtout qu’il n’a fait que brosser un diagnostic réaliste et objectif de l’état de nos cités.
Ce parti-pris peut se discuter mais le comportement de l’impétrant fait tâche sur les habits neufs de « jeune cinéaste prodige » « repenti et consensuel » qu’on lui a fait endosser. Les choses auraient pu en rester là si l’élite parisienne, arbitres des élégances, ne s’était pas entiché de ce film au point de le propulser dans la courses aux Oscars, catégorie du « meilleur film étranger ». Voyez plus tôt : « Le meilleur film des banlieue qu’on ait réalisé en France » clame Michel Ciment, un des critiques des cinéma les plus reconnus. « Film coup de point », renchérit 20 minutes, « Oeuvre sidérante » , assène le quotidien La Croix. N’en jetez plus !
Au demeurant ce n’est pas la première fois que le milieu culturel de gauche se pâme devant un film mettant en scène les cités ou encore les jeunes « issus de la diversité ». Cela me rappelle l’engouement de La Graine et le Mulet du franco-tunisien d’Abdellatif Kechiche ou encore Entre les murs de Laurent Cantet qui avait obtenu la palme d’or il y a quelques années. J’avais pointé à son propos la violence institutionnelle de l’école que ce film légitime.
Ici la violence n’est pas institutionnelle mais atavique dans ce rapport instinctif avec ses origines polythéistes : la loi du Talion. Les trois monothéismes, issues d’ailleurs de la même souche sémite, ont cherché depuis toujours à le juguler. Mais pour ce faire, ô paradoxe, il fallait convertir les plus grand nombre d’ouailles. D’où la sanglante et multiséculaire compétition entre eux. Croire ou périr !
Aujourd’hui alors que le religieux revient en force dans l’espace public, la compétition s’est ravivée pour savoir qui aura l’autorité morale pour contrôler la violence légitime, apanage de l’État. C’est cette guerre d’influence silencieuse et secrète que donne à voir en creux ce film. Certes c’est bien vu mais aussi, mine de rien, quelque peu orienté… car si les déterminants sociaux pèsent de tout leur poids dans la genèse de la violence urbaine, comme l’illustre le film, ils n’en sont pas les uniques responsables. Il y encore et toujours le libre arbitre de la personne. C’est là où ce film montre ses limites. Abordant également le même thème de façon tout aussi spectaculaire la réalisatrice de « Divines » Houda Benyamina s’est montrée plus circonspecte s’attachant à décrire aussi la complexité de la subjectivité humaine qui l’engendre.
Ce que permet de situer ce film à son juste niveau : un film de bonne facture certes mais qui est loin d’être le parangon du cinéma d’auteur auquel on veut le destiner.
Dès lors comment expliquer l’aveuglement du milieu culturel parisien à son égard ? La culpabilité et la mauvaise conscience n’y sont pas étrangères. Ce passé colonial qui ne passe pas, voile au sens propre et figuré l’analyse sur sa propre situation et du coup la guerre idéologique qui s’y déroule. « Quel étrange spectacle de que de voir des anticléricaux forcenés, des bouffeurs de curé perdre tout sens commun faces aux culs-bénits du fondamentalisme » s’étonne encore Pascal Bruckner.
Interrogé sur les raisons qui ont conduit Daesh à attaquer la France, un djihadiste a donné cette explication fort éclairante : parce que la France constitue la boîte à idées de l’Europe ! On ne sera pas alors étonné si l’Académie du cinéma de Hollywood couronne ce film ne ratant pas ainsi l’occasion de rendre la monnaie de sa pièce à son turbulent ami qui pense que la laïcité est une valeur universelle.
Car la lutte d’influence qui se déroule a aussi des conséquences philosophiques et politiques. Qui remportera le match ? L’universalité des droits et des valeurs humanistes et collectives ou l’intérêt particulier de l’individu fier défendre sa différence par le libéralisme ? Encore faut-il que l’intérêt personnel ne verse dans l’ultralibéralisme et ses alliances douteuses avec les fondamentalismes. La vertu, comme le disait déjà Cicéron, se trouve toujours au milieu. Et ceci est loin d’être acquis.
Ce magistère réel ou supposé se paie parfois au prix du sang des innocents et demande pour l’assumer d’être à la hauteur c’est-à-dire avoir une très fine connaissance de l’imbrication de ce deux aspects de la nature humaine qui est en même temps sociale. C’est tout l’enjeu d’une diversité culturelle bien tempérée et de l’État culture qui en serait l’expression.
A bon entendeur…