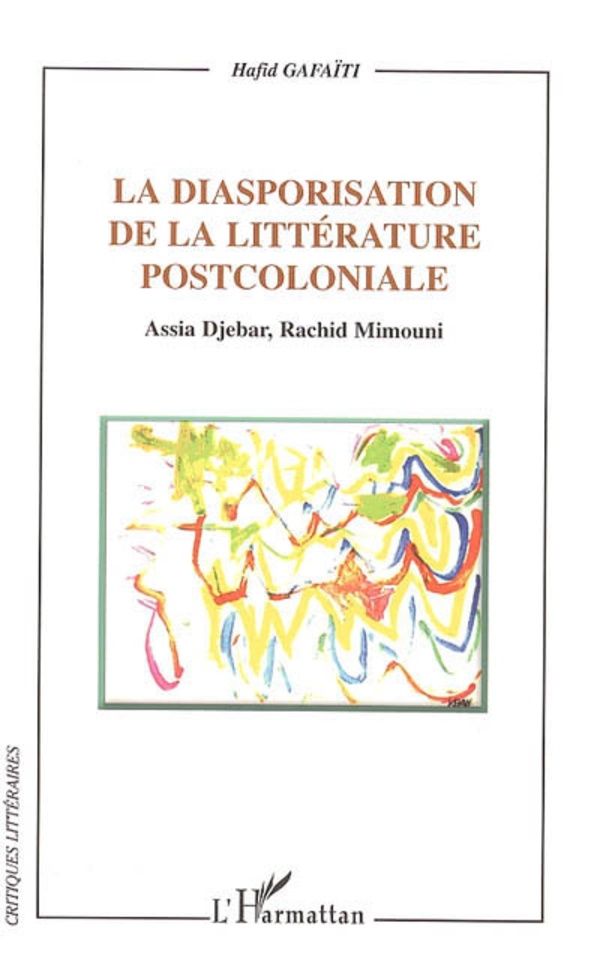Chroniques inactuelles
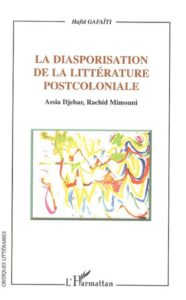
Fulvio Caccia
Les littératures postcoloniales sont-elles vouées à la diasporisation pour obtenir leurs lettres de noblesse ? C’est l’interrogation capitale que pose en filigrane Hafid Gafaiti dans un essai homonyme qu’il consacre à la littérature algérienne actuelle. Pour ce faire, l’essayiste qui est également excellent poète analyse avec acuité son avènement à travers le parcours de deux écrivains emblématiques : Rachid Mimouni et Assia Djebbar.
Le statut de la langue est cœur de cette réflexion. Dans quelle langue écrire ? Et donc pour qui ? Pour les lecteurs du pays ? Pour les lecteurs français ? francophones du monde? Cette question n’est pas nouvelle. Elle se pose encore aujourd’hui de manière lancinante aux nombreux écrivains issus des décolonisations ; elle n’aura cessé de hanter cette génération d’Algériens, héritiers d’une indépendance qui les trahira. Obligés de choisir entre la langue de l’ancien colon et l’arabe, ces écrivains qui ont d’abord été les hérauts de l’idéal révolutionnaire, seront peu à peu acculés à l’exil.
Pourquoi? Qu’est-ce qui a fait décliner le soleil des indépendances, pour filer la métaphore du titre fameux de Kourouma, vers le crépuscule de la corruption, de l’autoritarisme et du terrorisme ? C’est à cette histoire douloureuse et complexe auquel l’essayiste va s’atteler en reparcourant le chemin de ses aînés. Il le fera dans une langue précise, charpentée tout en demeurant métaphorique. L’œuvre des Kateb Yacine, Abdelwahab Meddeb, Nabile Fares, Rachid Boudjedra apparaissent dès lors sous la plume de l’essayiste comme autant de jalons pour faire advenir une littérature nationale « entre affirmation nationale et mondialité. »
Mais cela ne va pas de soi. Car la lutte interne qui s’engage est idéologique et philosophique autant qu’économique. Elle confronte les tenants d’une rupture radicale avec la littérature française et ceux qui lui sont restés fidèles et qui doivent désormais en rendre compte. Le français, langue littéraire, deviendra ainsi le lieu de la mauvaise conscience postcoloniale, l’objet d’un amour-haine qui va marquer durablement cette génération d’écrivains. Rachid Mimouni et Assia Djebbar sont au cœur de cette contradiction.
Le Printemps n’en sera que plus beau, le premier roman du jeune Mimouni illustre d’abord l’idéologie nationaliste qu’encourage le Régime. Le nouvel état a favorisé pour ce faire la création de la Société Nationale d’édition et de diffusion (SNED) fondé en 1965 où publie alors Mimouni. Toutefois Une paix à vivre, son deuxième roman, n’aura pas la même chance. Il sera interdit de publication sept ans durant avant d’être publié censuré. C’est qu’entre temps le président Ben Bella est renversé par Boumedienne et le jeune étudiant légaliste descend dans la rue pour le faire savoir. La régime s’en souviendra. Désormais l’écrivain se trouve sur la voie l’exil.
Le fleuve détourné ; puis Tombeza marquent cette rupture. Dans un chapitre dédié à la réception de l’œuvre de Mimouni, l’essayiste en décrira les diverses modalités. La critique arabophone passera sous silence la critique sociale que ces romans contiennent comme d’ailleurs dans L’honneur de la tribu . Ici l’auteur cherche à trouver la parade dans le passé face à la machine du régime qui, sous les traits d’un jeune préfet, imbu d’idéalisme nationaliste, est bien décidé à assujettir sa ville natale de Zitouna aux diktats de la modernité.
Mais en opposant brutalement le traditionalisme autarcique au modèle économique libéral héritier de la métropole, le romancier tombe dans le piège qu’il veut dénoncer : le passé n’a jamais été un âge d’or égalitaire. C’est dans la Malédiction où il se montre plus convainquant en renvoyant dos à dos le régime militaire du FNL et le fanatisme religieux qui empoisonnent la société algérienne. Enfin il atteindra une sorte de plénitude dans Chronique de Tanger, son dernier opus. Le romancier consent enfin à s’exiler mais pas trop loin puisqu’il s’installe au Maroc. « Nous sommes tous des exilés, notre solitude est grande. Exilé de notre lieu , de nos souvenirs ou de notre source de vie,. Exil de notre passé, de nos désirs, d’un visage aimé ou d’un sexe qui s’offre dans l’intimité de la nuit… Exil de nos racines, et du temps qui passe et surtout de cet exil extérieur qui nous tient éloigné de nous mêmes. »
Cette condition de l’exil, Assia Dejbbar l’approfondira à travers un écriture qui va de la nation à l’expatriation par delà cinq décennies et une bonne vingtaine de titres. Mais c’est dans les voix qui m’assiègent que la romancière confirmera ce détachement de leur patrie auxquels sont assujettis les écrivains postcoloniaux, héritant par le fait même de cette mauvaise conscience qui les pousse malgré tout à écrire. La guerre civile avec ces massacres sauvages et gratuits, notamment des villages de Raïs et de Benthala, lui en donnent une douloureuse occasion.
J’écris la langue des morts ou la mienne qu’importe
J’écris une langue offensée
humiliée
une langue d’orangeraie
j’écris française
langue vivante
sons écorchés
J’écris vos voix pour ne pas étouffer
vos voix dans ma paume dressées
Raïs, Benthala, j’écris l’après. «
Ce combat de résistance, elle le conduit autant en tant que femme que comme algérienne. Parus respectivement en 1985, 1987, et 1995 L’amour, La fantasia, Ombre sultane et Vaste est la prison, marquent les étapes de cette prise de conscience progressive de la femme maghrébine. Par la description de la condition féminine avec ses aléas et ses assignations à résidence, l’écrivaine dévoile les contradictions qui la maintiennent dans son rôle traditionnel. La question centrale, elle le formulera elle-même : « Que cela signifie-t-il dans un pays musulman d’avoir quatre femmes ? »
Poser cette question, c’est interroger l’archaïsme patriarcal que renforce l’idéologie religieuse et la domination entre les sexes. La romancière la poursuivra au travers cette quête qu’interrompt la guerre civile des années 1990. Un texte majeur Le blanc de l’Algérie, à mi chemin de l’essai et du témoignage, cherchera à en rendre compte. Mais l’œuvre essentielle qui synthétise toute sa démarche c’est assurément La disparition de la langue française paru en 2003 .
Berkane, le narrateur revient à Alger après deux décennies d’exil. Sa rupture avec Marise, son amante française en est le ressort. Dans le pèlerinage à travers la ville de son enfance, ce fonctionnaire, écrivain à ses heures, rencontre Nadjia, une Algérienne, elle-même exilée. Ce chassé-croisé amoureux et mémoriel qui commence à l’automne 1991 se terminera par la disparition du narrateur, kidnappé ou assassiné par un groupe de terroristes.
Cette disparition inopinée renvoie, on ne peut plus clairement, à la construction de l’identité collective stoppé brutalement par la violence mimétique qui la détruit de l’intérieur. Le choix du titre à cet égard n’est pas innocent ; il renvoie autant au recul du français comme langue de communication en Algérie que l’échec d’une langue commune dont le personnage principal est le porteur. Cette langue commune n’est pas l’arabe administratif que tente d’imposer l’État ni celle de l’ancien pouvoir métropolitain. C’est celle du Dolce stil novo de Dante qui fait du « vulgaire » une langue « illustre » en le rendant digne de célébrer l’amour par l’écriture dont elle est le support. C’est e quelque sorte un nouvel usage de la langue , une surconscience linguistique qu’il s’agit d’exercer. Car celle-ci est politique pour le meilleur – la poésie et sa reconnaissance populaire – ou le pire- sa manipulation idéologique.
Cette mission que l’on pourrait qualifier de transhistorique, c’est de fait Nadjia qui en devient l’héritière. Doublement Comment ? En traduisant les autres langues et en s’exilant une autre fois. « Si la terre n’est pas en effet le noyau du monde, notre pays, n’est qu’un couloir, un tout petit passage entre l’Andalousie perdue et mythique et tout l’ailleurs possible ! ». Et cette possibilité de l’ailleurs c’est l’héritage transculturel, engrammé dans toutes les langues qui fondent la condition humaine. « Il existe, disait le philosophe Paul Ricoeur, entre l’activité de raconter une histoire et le caractère temporel de l’expérience humaine une corrélation qui n’est pas purement accidentelle, mais présente une forme de nécessité transculturelle. » Nécessité transculturelle qui conduit le récit national à transcender la violence mimétique qui l’a engendré au travers sa diasporisation, sa dissémination pour atteindre ainsi une sorte d’universel.
Mais dès lors la question du début se repose plus que jamais cruciale aujourd’hui ? Cette dissémination, pour reprendre l’expression chère à Derrida, est-elle la condition de toute littérature postcoloniale et par devers elle, de toute toute littérature à l’heure du numérique et de la mondialisation ? ou pour le dire autrement est-ce la rançon politique que doivent payer les nouvelles identités collectives qui veulent advenir ?
Dans un essai lumineux, intitulé le Modèle tétralinguistique, le linguiste Henri Gobard, explique que les langues se distribuent en fonction de leur rapport de force entre elles. Un observateur avisé pourrait y lire leur destin qui va de la naissance ( vernaculaire) à la disparition ( sacré) en passant par la consécration (véhiculaire) et la maturité (référentiaire).
Si l’on suit cette logique historique et quaternaire, le déclin d’une longue serait aussi le moment de sa plus grande dispersion qui est aussi son assomption et sa renaissance symbolique. La francophonie, fruit de la décomposition de l’empire colonial, constituerait ainsi une sorte de supernova subsumant sa mauvaise conscience en « humanisme radical » cher à Léopold Sedar Senghor, tout en permettant aux littératures métropolitaines de se « rajeunir ». Nous n’y trompons pas. Voici ce qu’écrivait Albert Camus à Mouloud Feraoun à la fin de 1957: « Si par-dessus les injustices et les crimes, une communauté franco-arabe a existé, c’est bien celle que nous avons formée, nous autres écrivains algériens, dans l’égalité la plus parfaite. Pour ma part, je ne me suis pas encore résigné à cette séparation. »
On ne saurait être plus clair. Cette séparation est bien celle qui consiste à renoncer au pouvoir poétique de la langue, c’est à dire sa puissance d’agir, sa capacité de « faire » et donc de tracer ici et maintenant un chemin de traverse dans l’aporie de la violence qui oppose deux extrêmes aussi inacceptables l’un que l’autre.Ce chemin de traverse c’est celui de la « pensée de midi », pensée tragique, qui maintient la langue sous tension et l’empêche d’être instrumentalisée par les pouvoirs quels qu’ils soient.
Aujourd’hui plus que jamais cette Pensée du midi, forgée en Algérie, met à l’épreuve toute les littératures du monde car elle leur révèle leur force de gravité autant que leur impondérable légèreté. L’exil comme mouvement, diasporisation, n’est plus physique mais devient le vecteur transculturel de l’espace public désormais mondialisé. Tel est la leçon de ces écrivains algériens et de ce remarquable essai.